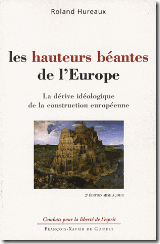|
| Accueil |
Créer un blog |
Accès membres |
Tous les blogs |
Meetic 3 jours gratuit |
Meetic Affinity 3 jours gratuit |
Rainbow's Lips |
Badoo |
[ Contacts/Adhésions/ Vie du mouvement ] [ Canton de Rouvroy - Méricourt - Drocourt + Bois Bernard (CACH) ] [ Canton d'Hénin Beaumont - Noyelles Godault ] [ Canton de Leforest - Evin Malmaison - Dourges - Courcelles lès Lens ] [ Canton de Montigny en Gohelle - Hénin Beaumont ouest ] [ Canton de Carvin Libercourt ] [ Canton de Courrières - Oignies ] [ Généralité ] [ TV/Radio/Vidéo/Net et autres médias ] [ TRIBUNE LIBRE ]
|
|
|
|
L’Europe au début de l’hiver
22/12/2009 12:25

 Parmi les patriotes que nous sommes, beaucoup, pourquoi ne pas l’avouer ? ont pensé que la mécanique supranationale de la Constitution européenne calerait avant d’aller jusqu’au bout. Parmi les patriotes que nous sommes, beaucoup, pourquoi ne pas l’avouer ? ont pensé que la mécanique supranationale de la Constitution européenne calerait avant d’aller jusqu’au bout.
La cause nous paraissait entendue après le double référendum négatif de mai-juin 2005, en France et aux Pays-Bas.Quand fut mis en chantier le traité de Lisbonne, clone de la défunte Constitution, même illusion : le refus irlandais, les difficultés polonaises, la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe tendant à préserver la souveraineté du Parlement allemand, le blocage obstiné du traité par Vaclav Klaus, président de la République tchèque, la perspective d’un référendum britannique nous avaient laissé espérer jusqu’ au dernier moment que l’affaire capoterait.
Considérant à juste titre que ces consultations partielles exprimaient l’hostilité de la plupart de peuples d’Europe au processus d’intégration en cours, nous pensions naïvement que, dans une Europe aux fortes traditions démocratiques, les peuples auraient en définitive le dernier mot.
Et bien non ! Nous nous sommes trompés. En cette fin de 2009, le traité de Lisbonne entre en application.
On pourra certes se consoler encore en considérant que les grands pays gardent la maitrise des orientations essentielles (ou de l’absence d’orientations !) : plan de relance, politique étrangère, nomination des personnalités clef de l’Union. La France et l’Allemagne ont ainsi imposé , en application du traité de Lisbonne, un président de l’Union européenne honnête mais falot Herman Van Rompuy ( dont l’absence sur la scène intérieure risque de coûter cher à la Belgique ) et un haut-représentant aux affaires étrangères, Catherine Ashton, femme de cabinet sans légitimité démocratique, dont on peut se demander si les Britanniques ne l’on pas désignée pour ridiculiser la fonction.
Mais là aussi, il ne faut pas se réjouir trop vite. Car ce qu’il ya de plus redoutable dans la machine européenne se situe au niveau intermédiaire, celui où règne en maître la commission. Une commission beaucoup plus puissante depuis que l’Europe se fait à 27.
Le succès final du processus de ratification du traité de Lisbonne a montré que, malgré tous les obstacles, l’hydre bureaucratique bruxelloise étendait ses tentacules de manière inexorable et que, forte de sa puissance administrative, de sa patience et du caractère dispersé et intermittent des résistances, elle finissait , comme toute machine idéologique, à arriver au but qu’elle s’était fixé.
Or c’est au niveau de la bureaucratie qu’il y a lieu de craindre les effets de la ratification. Après avoir connu plusieurs années de morosité, liées aux résistances des peuples, la bureaucratie européenne vit aujourd’hui dans l’euphorie. La signature du traité de Lisbonne a libéré sa volonté de puissance.
Longtemps frustrés, les technocrates de Bruxelles veulent à présent mettre des bouchées doubles pour achever le processus d’intégration. La directive Bolkestein, aux effets si déstabilisateurs sur le marché du travail, un temps gelée, entre en application. Forte de la création d’un ersatz de ministère des affaires étrangères, la Commission a commencé à recruter 5000 diplomates qu’elle déploiera à travers le monde, à l’égal d’un Etat. Ce nouveau réseau diplomatique ne manquera pas de dévaluer les ambassades des pays membres. A la première contrainte budgétaire, un gouvernement français d’orientation européiste pourrait tirer prétexte de son existence pour alléger notre propre dispositif, dont l’étendue fut longtemps un facteur de rayonnement pour notre pays. Les Pays-Bas y pensent déjà.
Le traité de Lisbonne a d’importantes conséquences en matière de justice et de sécurité et donc de contrôle de l’immigration : dans ces domaines, les décisions pourront être prises à la majorité. La formation de policiers européens est à l’étude. Ne doutons pas que Bruxelles se précipitera pour occuper ces nouveaux territoires où pourtant elle est loin d’avoir fait ses preuves
Le travail d’unification des normes de toutes sortes, en application de l’Acte unique de 1987, destiné à parachever le marché intérieur, va se poursuivre.
En matière agricole, les crises du lait et celle des fruits et légumes ont montré le caractère impitoyable de la mécanique bruxelloise dès lors qu’il s’agit d’écraser les petits et les dégâts du tout-marché qu’elle cherche à instaurer. Pourtant la commission a fait circuler un mémorandum destiné à redéployer vers d’autres secteurs les dépenses de régulation des marchés agricoles, lesquelles seraient réduites de 60 à 30 % du budget communautaire. Heureusement, une offensive française relayée par l’Allemagne semble faire échec à ce plan. Pour combien de temps ?
Bien que le coup vienne de Strasbourg et non de Bruxelles, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, au mépris du principe de subsidiarité et du souhait de la majorité de Italiens , d’interdire les crucifix dans les écoles d’ Italie, montre jusqu’à quel point l’idée d’un droit abstrait , désincarné, étranger à la volonté des peuples, fait son chemin.
La manière dont le président du Parlement européen a tenté d’empêcher de parler Nigel Farage, brillant député britannique eurosceptique, montre le climat d’intolérance qui règne plus que jamais dans une machine désormais remise sur les rails.
A ce regain d’activisme bruxellois, répond une soumission grandissante des administrations nationales pour lesquelles le droit européen est devenu, en France au moins, la loi et les prophètes. Le Conseil d’Etat vient de décider que les directives européennes étaient immédiatement exécutoires avant même leur inscription dans le droit national. C’était déjà la position – contestable – de la Cour de justice européenne mais pas encore celle des juridictions nationales. Le Parlement français, qui n’a même plus à intervenir, se trouve ainsi un peu plus dévalué.
En réussissant à mettre en œuvre le traité de Lisbonne malgré la volonté de peuples, la machine européenne a franchi un pas dont nous ne mesurons peut-être pas encore les conséquences. Quelque part, l’Europe est désormais sortie du « cercle de la démocratie ». L’étonnante « investiture » de Herman van Rompuy par le groupe de Bilderberg a valeur de symbole. Cette capacité d’arriver à ses fins en contournant tous les obstacles est typique d’un régime idéologique, appliquant la maxime de Lénine : « deux pas en avant, un pas en arrière ». Jusqu’ où nous mènera cette machine infernale en marche, dès lors qu’elle a démontré qu’elle pouvait passer outre avec succès à la volonté populaire clairement exprimée ? Nul ne le sait.
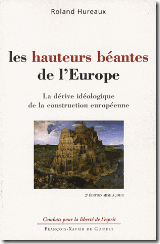 Que l’Europe ne compte plus beaucoup de vais croyants ne doit pas nous rassurer. Hannah Arendt a montré comment les régimes idéologiques continuaient longtemps à fonctionner alors même que leurs cadres avaient perdu la foi. Leurs bureaucrates n’en étaient même que plus impitoyables. Que l’Europe ne compte plus beaucoup de vais croyants ne doit pas nous rassurer. Hannah Arendt a montré comment les régimes idéologiques continuaient longtemps à fonctionner alors même que leurs cadres avaient perdu la foi. Leurs bureaucrates n’en étaient même que plus impitoyables. Nous émettions l’hypothèse dans un ouvrage paru il ya dix ans (1) qu’il y avait entre un régime véritablement totalitaire et le système idéologique européen la différence d’un étang revêtu d’une couche de glace épaisse et d’un autre où seulement flotteraient quelques plaques éparses. Mais on sait qu’il suffit que la température baisse de quelques degrés pour que celles-ci se soudent entre elles et que tout l’étang soit gelé
| |
|
|
|
|
|
|
|
Le fiasco de Copenhague est d’abord celui de l’angélisme européen
22/12/2009 06:42

Comme je l’écrivais vendredi dernier, rien n’est finalement sorti du sommet de Copenhague, que tant de dirigeants avaient fait miroiter au yeux des peuples.
Ce fiasco, au-delà des apparences, est bel et bien celui de l’Europe et de sa politique angélique, pour ne pas dire de sa contradiction majeure.
Comment en effet imaginer que la Chine et l’Inde allaient céder quoi que ce soit ? Ces deux pays sont devenus la machine à produire et à polluer du monde sous l’effet de la politique économique et commerciale de l’UE, qui les encourage dans cette voie avec son dogme du libre-échange intégral.
Copenhague révèle une fois de plus que la vraie fautive des déséquilibres mondiaux est une Europe ventre-mou, qui n’ose pas ou ne veut pas se donner les moyens de ses objectifs affichés. Les pays émergents n’ont aucun intérêt à se plier aux objurgations européennes et seule une taxe carbone aux frontières de l’UE changerait cette situation. Mais la Commission de Bruxelles, comme nombre de pays libre-échangistes, n’en veut pas…
Les euro-béats qui nous gouvernent, parmi lesquels les écologistes tendance Europe-Ecologie qui jouent aujourd’hui les pleureuses sur le sommet de Copenhague, se refusent à tout rapport de force dans le champ international, un peu comme les pacifistes et autres apaiseurs des années trente s’imaginaient dompter l’Allemagne nazie à coup de capitulations successives. C’est pourquoi, d’ailleurs, leur discours en faveur d’un « toujours plus d’Europe », style Lisbonne, est un leurre, une fuite en avant dans le néant de la volonté.
A Copenhague, c’est bel et bien l’angélisme européen - il est vrai mâtiné de cynisme - qui est mort. Il serait temps de s’en rendre compte, notamment en France, où le double langage des dirigeants, entre postures martiales et décisions minimalistes, n’aura jamais été aussi béant.
NDA
| |
|
|
|
|
|
|
|
Un nouvel abandon de la souveraineté européenne
21/12/2009 17:01

- Source : www.voltairenet.org
Une fois de plus l’Union européenne cède aux exigences de Washington sans contrepartie : les États-Unis auront légalement accès aux informations bancaires des Européens, dès que le Traité de Lisbonne sera entré en vigueur et que le Parlement européen aura avalisé le nouvel accord. Au demeurant, avant même le vote parlementaire, ces dispositions sont déjà appliquées. Jean-Claude Paye analyse cette nouvelle concession.
 Ces dernières années, l’Union européenne et les États-Unis ont signé un ensemble d’accords en matière de remise des données personnelles : informations PNR des passagers aériens [1], données financières dans le cadre de l’affaire Swift [2]. Un projet de transfert général est en préparation. Il s’agit de remettre, en permanence aux autorités américaines, une série d’informations privées, telles le numéro de la carte de crédit, les détails des comptes bancaires, les investissements réalisés, les connexions internet, la race, les opinions politiques, les mœurs, la religion [3].
Progressivement, l’Union transforme sa propre légalité, afin de permettre au droit états-unien de s’appliquer directement sur son territoire. Chaque nouvel accord constitue un nouvel abandon de souveraineté des pays membres de l’Union européenne. Le texte qui vient d’être signé entre l’UE et les USA, en matière de saisie des données financières, en est un exemple éclairant.
L’affaire Swift
Ce 30 novembre 2009, le Conseil des ministres de l’Intérieur de l’Union européenne a avalisé le projet d’accord établi par la Commission, qui permet aux autorités US de se saisir, sur les serveurs de la société Swift placés sur le sol européen, des données personnelles financières des citoyens des pays membres de l’Union. Cette ratification par le Conseil est la dernière étape du processus destiné à mettre fin au scandale de l’affaire Swift et à toute contestation du droit que se sont octroyé les États-Unis de se saisir des informations financières concernant les ressortissants européens.
L’affaire Swift avait éclaté lorsque, en 2006, la presse états-unienne avait révélé que cette société avait, depuis les attentats du 11 septembre 2001, transmis clandestinement, au Département du Trésor US, des dizaines de millions de données confidentielles concernant les opérations de ses clients. Swift, société américaine de droit belge, gère les échanges internationaux de quelques 8 000 institutions financières situées dans 208 pays. Elle assure le transfert de données relatives aux paiements, mais ne fait pas transiter d’argent.
Malgré la violation flagrante des droits, européen et belge, de protection des données personnelles, ce transfert n’a jamais été remis en cause. Au contraire, l’UE et les USA ont signé plusieurs accords destinés à légitimer cette capture.
Tous ont été justifiés par la lutte contre le terrorisme. La saisie par les autorités US était rendue possible par la particularité du système Swift. En effet, toutes les données contenues par le serveur européen, installé à La Haye, étaient également placées sur un second serveur placé aux États-Unis. Ce qui permettait aux douanes états-uniennes d’en prendre possession, le droit américain autorisant cette saisie.
Un nouvel accord UE-USA
Toutefois, depuis juin 2007, il a été prévu que les données Swift inter-européennes ne soient plus transférées aux USA, mais sur un second serveur européen. Cette nouvelle procédure s’avère formellement plus conforme au droit européen et supprimerait la possibilité des autorités états-uniennes de se saisir de ces informations. Ce nouveau serveur placé à Zurich est opérationnel depuis novembre de cette année.
 Suite à cette réorganisation et contrairement à ce qui était affirmé lors des précédents accords, le Commissaire européen à la Justice Jacques Barrot a expliqué que les Vingt-Sept souhaitent donner, aux enquêteurs du Trésor américain, accès aux centres d’opérations européens gérés par Swift. Il a déclaré que « ce serait extrêmement dangereux à ce stade de cesser la surveillance et le contrôle de ces flux d’informations » [4] et affirmé que les opérations américaines sur le serveur américain de Swift s’étaient révélées « un outil important et efficace ». Il a simplement repris les déclarations du juge Bruguière, la « personnalité éminente » [5] désignée par la Commission pour « contrôler » l’utilisation américaine des dizaines de millions de données transférées chaque année. Ce dernier avait prétendu que cette saisie avait « permis d’éviter un certain nombre d’attentats ». Aucun exemple, permettant de vérifier ces allégations, n’a été avancé. L’énonciation du caractère indispensable de la capture des données financières devient la preuve du succès de cette politique dans la lutte contre le terrorisme. Une identité est établie entre le mot et la chose. Suite à cette réorganisation et contrairement à ce qui était affirmé lors des précédents accords, le Commissaire européen à la Justice Jacques Barrot a expliqué que les Vingt-Sept souhaitent donner, aux enquêteurs du Trésor américain, accès aux centres d’opérations européens gérés par Swift. Il a déclaré que « ce serait extrêmement dangereux à ce stade de cesser la surveillance et le contrôle de ces flux d’informations » [4] et affirmé que les opérations américaines sur le serveur américain de Swift s’étaient révélées « un outil important et efficace ». Il a simplement repris les déclarations du juge Bruguière, la « personnalité éminente » [5] désignée par la Commission pour « contrôler » l’utilisation américaine des dizaines de millions de données transférées chaque année. Ce dernier avait prétendu que cette saisie avait « permis d’éviter un certain nombre d’attentats ». Aucun exemple, permettant de vérifier ces allégations, n’a été avancé. L’énonciation du caractère indispensable de la capture des données financières devient la preuve du succès de cette politique dans la lutte contre le terrorisme. Une identité est établie entre le mot et la chose.
Des justifications en trompe l’œil
L’énonciation de la lutte contre le terrorisme suffit à justifier la capture des données financières. Cependant, la réalité nous montre que les attentats sont généralement sont peu coûteux et ne nécessitent aucun déplacement important d’argent. . La raison invoquée prend un caractère surréaliste quand on sait que la commission officielle d’enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 n’a pas voulu investiguer sur les mouvements de capitaux suspects, enregistrés les jours précédents les attentats. Pourtant, juste avant les attaques du 11 septembre, le 6, 7 et 8, il y a eu des options de vente exceptionnelles sur les actions des 2 compagnies aériennes [Americain et United Airlines] qui furent détournées par les pirates, ainsi que sur Merril Lynch, l’un des plus grands locataires du World Trade Center. Ces informations ont été révélées notamment par Ernst Welteke, président de la Deutsche Bank à l’époque, qui a aussi déclaré qu’il y avait beaucoup de faits qui prouvent que les personnes impliquées dans les attaques profitèrent d’informations confidentielles afin de réaliser des opérations suspectes [6]. Tous ces éléments, le fait qu’un attentat terroriste ne nécessite pas d’importants transferts de fonds et la volonté politique de ne pas enquêter sur les transferts financiers suspects, nous indiquent que la capture des données financières des citoyens est bien un objectif en soi.
Souveraineté états-unienne sur le sol européen
La Commission a voulu d’abord signer un accord transitoire, qui a pris effet dès la mise en route du serveur de Zurich. Le processus de décision a été confié à la présidence suédoise et au Conseil, rejetant ainsi toute possibilité de décision partagée avec le Parlement. Cela a toute son importance car le Conseil suit quasiment toujours les positions des fonctionnaires permanents et ceux-ci, se révèlent, le plus souvent, être de simples relais des négociateurs américains. Le commissaire Jacques Barrot affirme réaliser un accord équilibré, mais il a dû reconnaître que le texte actuel n’inclut pas l’accès des autorités européennes aux transactions bancaires états-uniennes [7].
À cet accord transitoire doit succéder un texte définitif, tout aussi unilatéral. Il s’agirait, après 9 mois, de « renégocier » ce qui a été accepté dans l’urgence. Cet accord devrait être avalisé par le Parlement européen, quand le Traité de Lisbonne, qui donne à cette assemblée plus de pouvoirs en matière de police et de Justice, sera d’application. La volonté affichée d’attendre la ratification du Traité indique qu’il s’agit de faire reconnaître, par le Parlement, un droit permanent des autorités américaines de se saisir, sur le sol européen, des données personnelles des citoyens de l’Union. Les nouveaux « pouvoirs » accordés au Parlement trouvent leur raison d’être dans la légitimation des transferts de souveraineté de l’UE vers les USA.
Cette position a le mérite d’être transparente, de présenter le Traité, non pas comme un texte constitutionnel interne à l’Union, mais comme un acte d’intégration de l’UE dans une entité supranationale sous souveraineté états-unienne. Ce nouvel accord qui permet aux autorités US de capturer, sur le sol européen et sans aucune réciprocité, des données personnelles des citoyens de l’Union, représente un nouveau pas dans l’exercice de la souveraineté directe des institutions étasuniennes sur les populations européennes.
Une structure impériale asymétrique
La capture US des informations sur les citoyens européens, surtout celles relatives à leur transactions financières, doit être replacée dans le cadre de la formation du futur grand marché transatlantique à l’horizon 2015 [8]. Les accords, qui autorisent ce transfert vers les USA, ne constituent qu’une étape préparatoire, la condition préalable permettant l’installation d’un grand marché transatlantique [9], ainsi que la constitution d’une entité politique commune. Ayant pour base le droit états-unien, ce projet s’avérera être un grand marché des données personnelles, à travers lequel, ces informations confidentielles seront livrées au secteur privé. La transformation de la vie privée en marchandise va de pair avec sa surveillance policière, cette dernière étant la condition d’existence de la première. La capture des données par les autorités administratives étasuniennes constitue une nouvelle accumulation primitive capitaliste ayant pour objet l’installation de nouveaux rapports de propriété basé sur la fin de la propriété de soi.
 Le caractère asymétrique de la capture des données personnelles : les autorités américaine ayant accès aux données européennes, sans qu’il soit question d’une quelconque réciprocité, nous révèle que au niveau du futur grand marché transatlantique, toutes les entreprises seront égales, mais certaines, les firmes US, le seront plus que d’autres. Le caractère asymétrique de la capture des données personnelles : les autorités américaine ayant accès aux données européennes, sans qu’il soit question d’une quelconque réciprocité, nous révèle que au niveau du futur grand marché transatlantique, toutes les entreprises seront égales, mais certaines, les firmes US, le seront plus que d’autres.L’utilisation par les autorités états-uniennes des données financières recueillies lors de « la lutte contre le terrorisme » a déjà commencé dans le cadre de « la lutte contre la fraude fiscale », dont les attaques contre la banque suisse UBS [10] et l’instrumentalisation du G 20 du 1er et 2 avril 2009 [11] ont été les épisodes les plus médiatisés.
| |
|
|
|
|
|
|
|
COPENHAGUE : LA GLOBALISATION DANS L’IMPASSE
21/12/2009 13:09

Qu’on croit ou non à la thèse du réchauffement climatique (échaudés, si l’on peut dire, par le système politico-médiatique du mensonge systématique où nous baignons, il reste des sceptiques malgré les évidences accumulées) , Copenhague avait d’autres enjeux : celui de la pollution mondiale et de l’épuisement des ressources naturelles.
Surtout, le sommet avait été présenté depuis des mois comme une démonstration ce que la “gouvernance mondiale” serait capable de faire en positif, après trente ans de dérégulation économique sauvage.
Après la plaisanterie du G20, qui n’a rien changé au système de domination de la finance sur l’économie réelle, l’échec de Copenhague est une nouvelle démonstration ce que les bienfaits annoncés de la globalisation mondiale sont de la poudre aux yeux. Tant qu’il est question d’entretenir la formidable pompe à finance qui aspire la richesse vers le haut au profit d’une petite oligarchie internationale, toutes les institutions internationales en charge du hold-up ont démontré leur compétence. Mais dès qu’il s’agit de démontrer que le dumping social généralisé, la sauvagerie économique, la destruction des nations sont un mauvais moment à passer pour des lendemains qui chanteront, les acteurs de la globalisation, Etats et institutions internationales, affichent leur impuissance et leur absence de volonté.
La faute à la Chine et aux USA, lesquels ont cependant fait des concessions ? Mais qui donc nous chante les vertus indétrônables du leadership américain depuis trente ans ? Qui donc a fait de la Chine cette superpuissance gorgée de dollars et d’investissements mondiaux attirés par le bas-coût de la main d’œuvre et par un système postcommuniste où les droits des travailleurs n’existent pas ? Le résultat : les champions de la globalisation restent les puissances les plus nationalistes de la planète. Quand à l’Union Européenne, qui a renoncé depuis vingt ans à défendre les nations qui la composent pour se faire le premier de la classe de la libre circulation économique mondiale, pouvait-elle espérer que son discours écologiquement correct compenserait magiquement tous ses abandons ?
Comme à l’accoutumée, Nicolas Sarkozy nous chante une agréable chanson volontariste. Mais comme lors du G20, il revient les mains vides, parce que le système international qu’il défend en réalité, celui du traité de Lisbonne imposé aux français du “non” par une classe politique traître à son pays, ne peut rien produire de bon pour les peuples et la planète.
Il n’y a qu’un seule solution pour faire payer et plier les pilleurs de ressources, les réchauffeurs et les pollueurs : réguler le libre-échange en rétablissant des frontières économiques raisonnables qui taxent le dumping social et le carnage écologique.
La France, pour elle-même, pour l’Europe et pour le monde, doit changer de cap et redevenir la championne d’une économie au service du développement humain.
François MORVAN 20 décembre 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
De Kaboul à Calais
21/12/2009 12:51

“De Kaboul à Calais”
de Wali Mohammadi
Edition : Robert Laffont
Date de parution : 05/11/2009
EAN13 : 9782221114131
Genre : Société
Résumé
Il lui a fallu de la chance, beaucoup de courage et de foi, et une bonne dose de folie. Son aventure, unique, est aussi un exemple parmi des milliers d'autres.
Ils sont des milliers chaque année à quitter l'Afghanistan et à affronter tous les dangers pour émigrer clandestinement : obligés de franchir déserts et montagnes, de traverser un ou deux bras de mer, il mettent souvent des mois pour atteindre leur but quand ils y parviennent. A Calais, ultime porte avant l'Angleterre, ils représentent environ 40 % des clandestins. Wali Mohammadi a été l'un d'eux. Son livre nous fait vivre de l'intérieur l'histoire de l'un de ces enfants perdus, victimes et témoins de la démence de notre monde.
Orphelin son père, emprisonné par les talibans, est mort sous la torture, sa mère a été déchiquetée par une bombe sur un marché , il a quitté Kaboul à l'âge de quinze ans, car il n'avait plus rien à perdre, sauf la vie. Après avoir vendu les biens de sa famille et confié son petit frère à des voisins, il décide de rejoindre sa soeur aînée à Londres et se lance dans l'aventure avec une liasse de billets en poche.
Wali fait ici le récit de son périple à pied, en bus, en voiture, en train, en bateau, en camion de Kaboul à Calais, via l'Iran,
la Turquie ,
la Grèce , l''Italie... Il raconte les espoirs, les angoisses, les frayeurs, les hasards, les folies de ce voyage (comme cette traversée en Méditerranée sur un petit bateau pneumatique). Il dévoile la chaîne complexe des passeurs, véritable économie fondée sur la contrebande d'êtres humains. Il témoigne aussi de rencontres riches, encourageantes. La générosité de villageois kurdes, la main d'un étudiant parisien guidant le réfugié dans le dédale du métro, et enfin l'abnégation de bénévoles calaisiens.
Wali ne terminera pas son périple en Angleterre. Car Calais le surprendra. Accueilli par une famille adoptive, il décidera de rester en France (où son petit frère le rejoindra). Et c'est muni d'un papier officiel qu'il franchira le Channel, quelques mois plus tard, pour rendre visite à sa soeur. Aujourd'hui, Wali possède un passeport français, travaille à Lille. Il peut aller comme bon lui semble à Londres ou à Kaboul. Mais il ne rêve que d'une chose : aider à la reconstruction de son pays.
Avis de PW
Poignante cette description du combat quotidien qu’ont à mener les immigrés en général. A conseiller a tous ceux qui voient en l’immigré un danger potentiel.
| |
|
|
|
|
 Parmi les patriotes que nous sommes, beaucoup, pourquoi ne pas l’avouer ? ont pensé que la mécanique supranationale de la Constitution européenne calerait avant d’aller jusqu’au bout.
Parmi les patriotes que nous sommes, beaucoup, pourquoi ne pas l’avouer ? ont pensé que la mécanique supranationale de la Constitution européenne calerait avant d’aller jusqu’au bout.